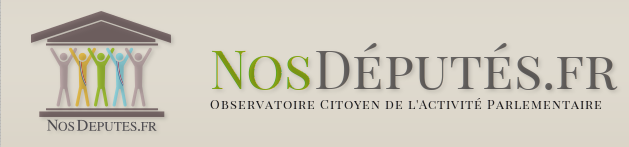Intervention de Antoine Boilley
Réunion du jeudi 8 février 2024 à 14h00
Commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre
Merci de votre invitation. Il est important pour l'Arcom d'avoir l'opportunité, dans le cadre de cette table ronde, d'effectuer un coup de projecteur sur un volet essentiel de nos missions en matière d'exception culturelle.
Permettez-moi, en préambule, de partager succinctement avec vous quelques éléments de contexte. Le cadre législatif et réglementaire de notre mission est défini par la loi du 30 septembre 1986, dont le principe fondateur est la liberté de la communication audiovisuelle.
Nous fixons aux éditeurs entrant dans notre champ de régulation un nombre important d'obligations en matière de production et de diffusion, dans le cadre de conventions spécifiques. Nous veillons au respect de ces obligations par des contrôles a posteriori.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur quatre décrets :
– le décret du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, dit « décret diffusion » ;
– le décret du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, dit « décret TNT » ;
– le décret du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dit « décret câble-satellite » ou « cab-sat » ;
– le décret du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande) et services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), dit « décret SMAD ».
Ce dispositif global, structuré, détaillé et mis en œuvre sur le long cours, répond à une ambition : proposer à nos publics en France et en Europe, dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, une offre de programmes français et européens d'envergure, pluraliste, exigeante et de qualité – et ce, dans tous les champs de la création.
Cette ambition a pour corollaire le développement et le maintien du bon fonctionnement d'un secteur économique diversifié de producteurs indépendants. Elle est au cœur de la régulation de la TNT, à savoir la gratuité d'usage des fréquences pour une période donnée, en échange de la fixation, au sein des conventions, d'un nombre important d'obligations de diffusion et de production.
La transposition en 2021 de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dite « directive SMA », a permis d'intégrer de façon dynamique dans notre champ de régulation les grandes plateformes internationales, qui doivent investir de manière significative dans la production française et européenne.
Notre action comprend, tout d'abord, la détermination, dans les conventions des éditeurs, d'obligations de production et de diffusion spécifiques, chiffrées et détaillées. Nous intégrons dans ces conventions, en restant fidèles aux termes des décrets, les accords professionnels signés par les opérateurs, avec les représentants de la production et les organismes de gestion collective. Nous menons aussi un travail d'instruction relatif au suivi et au respect par les éditeurs, piloté par la direction de la création de l'Arcom, dont je tiens à saluer ici le sérieux et le professionnalisme.
L'action de cette équipe se fonde sur deux composantes structurantes. En premier lieu, il s'agit de transmettre aux éditeurs assujettis leur niveau d'obligations de production pour l'année en cours. Ces obligations sont calculées en fonction des éléments de chiffre d'affaires de l'année précédente. En second lieu, l'équipe est chargée de vérifier, tout au long de l'année, le respect de leurs obligations par les éditeurs dans le cadre de l'élaboration de nos bilans.
Au regard des enjeux éditoriaux et économiques, cette instruction est détaillée et extrêmement minutieuse. Les équipes sont amenées à vérifier les quotas de diffusion des chaînes et le respect des obligations de programmation, à contrôler un grand nombre d'éléments liés à chaque investissement de production déclaré, à qualifier les œuvres sur lesquelles portent les investissements, et enfin à valider la conformité des investissements avec les engagements spécifiques pris en matière de production indépendante ou encore de clauses de diversité.
La bonne application de notre régulation réside dans l'instauration d'un dialogue constant et constructif avec les éditeurs et les représentants de tout l'écosystème du cinéma et de l'audiovisuel. Nous nous devons en effet d'accompagner l'ensemble du secteur dans la mise en œuvre de cette politique d'intérêt général. Nous veillons à être pragmatiques dans la mise en œuvre de ces obligations, en faisant en sorte que les investissements prévus dans la production soient toujours réalisés.
Pour autant, l'accompagnement des acteurs n'empêche aucunement la fermeté dans l'exercice de notre mission de contrôle. Au cours des dernières années, l'Arcom a ainsi été amenée à rappeler à certains éditeurs leurs obligations, à prononcer plusieurs mises en garde et mises en demeure, à décider de sanctions pécuniaires, exigeant par exemple des plateformes internationales de vidéo à la demande qu'elles rattrapent, en 2022 et au premier semestre 2023, plusieurs manquements constatés en 2021 sur leurs obligations de production de cinéma. Depuis, ces manquements ont été entièrement compensés.
Le dispositif encadrant le pouvoir de mise en œuvre et de sanction de l'Arcom en cas de manquement aux obligations de production a d'ailleurs été renforcé par le législateur, à travers la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, notamment à notre initiative. Ce nouveau dispositif permet donc d'accélérer une décision de sanction relative à ces obligations de production et de diffusion, et à accroître le montant maximal de la sanction.
Les résultats sont au rendez-vous. En 2022, dans le cadre du bilan annuel sur la synthèse de l'ensemble des engagements des éditeurs en matière de production audiovisuelle et cinéma, nous avons constaté que tous ces acteurs ont consacré près de 1,6 milliard d'euros au financement de la production audiovisuelle et du cinéma, contre 1,4 milliard d'euros pour l'exercice 2021 – soit une augmentation de plus de 12 % en un an.
Nous observons que le poids des services de télévision reste prépondérant, puisqu'ils totalisent près de 1,2 milliard d'euros sur le montant versé pour le financement de la production audiovisuelle et cinéma, soit 80 % des dépenses totales. D'autre part, les investissements des SMAD étrangers ont doublé entre 2021 et 2022, pour atteindre 345 millions d'euros. Cette somme représente 22 % des dépenses globales.
Sur les 1,6 milliard d'euros pris en compte par l'Arcom au titre des obligations des éditeurs, 1,2 milliard provient du secteur audiovisuel et 415 millions d'euros du secteur cinématographique.
En conclusion, la France est le pays d'Europe ayant adopté le dispositif le plus ambitieux et complet en matière de promotion et de protection de l'exception culturelle. L'Arcom en est le garant, aussi bien pour les acteurs de la télévision traditionnelle que pour les plateformes internationales de vidéo à la demande.
Notre boussole prioritaire reste l'intérêt du public. Force est de constater, comme le relèvent nos études et analyses régulières, que le public français et international plébiscite de plus en plus les créations françaises, dans tous les genres. Les acteurs de la TNT restent donc des piliers de notre politique culturelle. C'est pourquoi l'Arcom est très attentive à la pérennité et à la solidité de leur modèle économique à long terme, pour les acteurs publics autant que privés.